Conférence de Bernard Benattar sur l’estime de soi sous le patronage de Patrick Kanner du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Jeudi 26 février 2017, Fondation Apprentis d’Auteuil : 40 rue Jean de La Fontaine, 75 016 Paris.


Conférence de Bernard Benattar sur l’estime de soi sous le patronage de Patrick Kanner du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Jeudi 26 février 2017, Fondation Apprentis d’Auteuil : 40 rue Jean de La Fontaine, 75 016 Paris.

L’AIMF : Une culture de la médiation au service des villes : esprit et méthode
Bernard Benattar
___________________________________________________________________
En quoi, par quoi, pour quoi et comment l’AIMF aurait à promouvoir une culture de la médiation ?
Accompagner, soutenir la réflexion des Maires sur leur rôle, notamment en matière de cohésion sociale, de paix sociale, de participation citoyenne, de démocratie locale, par le biais de la médiation.
C’est aussi par une certaine manière de réfléchir ensemble à la médiation, qu’on fait médiation et ce n’est pas forcément en traitant des conflits qu’on fait médiation, c’est aussi parce qu’on met en résonance, en dialogue des valeurs communes, des horizons, des impasses, des insensés ou des sens. C’est aussi quand on met en résonance comme ça sur différentes strates les points de vue des uns et des autres qu’on fait médiation.
Je préfère le mot culture au mot méthode.
Dans notre méthode, il n’est pas question d’une progression linéaire vers un objectif clairement défini à l’avance ; il y a le fait de rebondir, de revenir patiemment, de se retourner:on éclaire une opinion, un fait saillant, un énoncé contradictoire puis on s’en éloigne du coté du concept, d’un texte, d’une expérience analogue, pour y revenir nourris du ou des détours. Par ces ces déplacements intempestifs, plus prés, plus loin, de l’objet principal, on crée une occasion concrète pour chacun, de s’arracher à ses évidences, de dépayser sa pensée. On cherche à déplacer les points de vue, non pas à les changer.
La médiation procède d’un art de l’occasion, qui relève d’une création singulière à chaque fois. La méthode n’épuise pas la manière.
Mots des stagiaires :
La médiation est une histoire de mise en mouvement, la méthode aussi qui vise une fluidité de la réflexion et des échanges. Elle est participative et cognitive. On regarde comment on pense, par où et quoi on pense. On ne regarde pas seulement ce qu’on pense, mais comment on l’a pensé. On fait de la médiation sans le savoir mais il est bon de le savoir et d’en connaître les ressorts et les effets. Un regard nouveau sur les blocages relationnels, une tentative pour vivre ensemble autrement. Sortir du système consensus mou, pour aller vers un système plus porteur d’avenir. Mesure, originalité. Anamnèse. C’est une rencontre. Organiser la rencontre. Un art autant qu’une méthode. La médiation comme recours à une situation bloquée, mieux que le recours à l’arbitrage. Rôle du tiers stimulateur et accoucheur, identification et traitement des affects. Traitement anticipé des crises larvées. Essayer de dégager une batterie de concepts pour essayer de constituer une stratégie de médiation. Démarche non dogmatique. Travail de reconnaissance. Exhumer.
Anamnèse :
Un questionnement qui permet de localiser et de circonstancier ta douleur chez le médecin. En médiation on s’occupe de ce qui fait mal, et de là où ça ne fait pas mal; ce qui importe c’est de discriminer, qualifier, localiser, distinguer.
Par exemple quand les Comoriens disent « on ne peut pas aller voir les autres Comoriens de l’île de la Grande Comore parce qu’on sait qu’ils nous méprisent » ils me parlent d’un mal et je leur réponds : « Depuis quand vous pensez ça, depuis quand cette idée là qu’ils vous méprisent est venue ? Dans quelles circonstances, comment elle a été confortée ? Est-ce qu’il y a une discontinuité là-dedans ? Est-ce que c’est seulement avec quelques personnes ? Lesquelles ? » Ce travail d’anamnèse n’est pas un travail de suspicion, mais un travail de localisation des problèmes, un travail de reconnaissance et d’attestation pour et par celui qui l’apporte.
L’apport de l’anamnèse : on sort d’une opinion générale et abstraite sans pour autant la dénoncer pour arriver à dire, mais au fait, cette opinion générale et abstraite, elle tient à quoi ? Ce qui va être notre matériau premier : opinion générale et abstraite. Ce qui devient notre matériau second : ce par quoi cette opinion générale et abstraite « singulièrement » a été énoncée.
Un procédé en médiation consiste à « délivrer » chacun de ses opinions qui sont des stéréotypes qui sont des sortes de généralités sur l’autre, formées à partir d’une histoire singulière et qui ont été répétées, répétées, répétées
Délivrer de l’opinion, cela veut dire aussi, déboucher l’accès peut être à ce à quoi on tient vraiment, à ce qui pourrait permettre de chercher des solutions, ou déboucher l’accès d’une idée possible de rencontre. Il y a un « donner la parole » qui a pour fonction, non pas d’établir un sens unique mais surtout d’en finir avec le non-sens.
Le facteur temps :
La médiation demande du temps. Elle établit des délais ou rétablit des délais, s’oppose à l’immédiateté de la réponse, permet de différer. Les élus disent beaucoup qu’ils ont à prendre 50 décisions à l’heure et qu’ils ont à trancher tout le temps. Quand l’élu se positionne du côté de « faire avancer des projets dans la concertation », faire médiation entre des intérêts apparemment contradictoires, ça veut dire qu’il lui faut sortir de cette urgence là, de temps en temps, ne pas être dans l’urgence de l’action et de la décision, mais être dans la lenteur de la réflexion.
La médiation comme alternative à l’arbitrage, ou comme alternative au tranchant de la loi.
Une ouverture des accès à l’autre et à d’autres contenus.
Aider à construire des compromis.
La médiation crée une occasion de légitimité nouvelle ou la parole de chacun vaut d’abord comme source de valeur unique avant de valoir comme position.
Instrument du dialogue et du rapprochement des cultures et des communautés.
Instauration et restauration du lien social. Réconciliation sans perdant ni vainqueur.
La ville médiatrice :
C’est d’abord une affaire de choix politiques : on prend le parti de relier ou d’articuler les communautés, les intérêts, les niveaux sociaux, etc.
Quand dans une grande ville Africaine, le maire mobilise des associations de quartier pour le ramassage des ordures, parce qu’il n’y a pas assez de camions poubelles , pas assez de moyens pour envoyer des camions poubelle tous les jours dans toutes les rues, et le jour où on a dit que les habitants prennent en charge cette histoire là et qu’on se mette d’accord pour le faire, là on a contribué à faire une ville médiatrice. Donc pour le rôle du Maire, faire ce choix que de dire «ce problème de ramassage des ordures, des animaux errants, etc. » soit ça se résout parce qu’on crée des moyens substitutifs, soit… On met à contribution des articulateurs, des vecteurs de rencontre et de co-responsabilité. Dans ce cas on fait de la médiation.
De quoi a besoin le Maire ?
Il a principalement besoin de rentrer dans cette culture là. C’est l’idée même de la médiation, c’est la culture même de la médiation, qui donne les idées subséquentes. Comment on s’y prend pour faire médiation, impliquer les habitants ? Il y a des milliers de moyens, mais ce qui fait que le Maire trouve ces moyens c’est qu’il est rentré dans cet esprit là, c’est qu’il veut bien chercher l’alternative à un mode autoritaire ou à un mode répressif de résolution des différends ou d’implication citoyenne de chacun.
Qu’est-ce qui va lui permettre de rentrer dans cette culture de la médiation ?
C’est parce qu’on va en discuter, c’est parce qu’on va y réfléchir, c’est parce qu’on va faire un partage d’expérience sur le sujet. Ils pensaient qu’ils pourraient instrumenter cette idée avant même qu’ils aient conçu l’idée, avant même de se poser la question. Donc pour y rentrer, il faut du temps, des illustrations, pouvoir mettre à l’épreuve ses propres manières de faire, ses choix. Il faut peut être même élucider ses choix. Permettre des accès les uns aux autres. Témoignage du maître d’ouvrage : Comme ils ne se rencontrent jamais, les gens du métier pensent toujours que les informaticiens sont de mauvaise volonté, qu’ils freinent toujours devant la tâche et les informaticiens pensent toujours, malgré l’interface (qui n’est pas médiatrice), que les gens du métier demandent des usines à gaz, demandent des trucs inutiles. Malgré ça la personne qui fait l’interface n’avait pas idée qu’elle pouvait faire médiation de temps en temps pour faire des cadrages, pour concevoir des grandes architectures générales de projet.
Imaginons qu’une personne décide de faire médiation entre 2 parties, concrètement qu’est-ce qu’elle fait ?
Ca dépend des gens, de l’histoire, des occasions qu’on a de « réunir ». Une fois j’avais fait une médiation entre un tribunal et un conseil général qui étaient en conflit. Pour moi ça consistait à écouter les uns, les autres, à aller voir qui pouvait parler aux uns et aux autres. Ca passait par plusieurs étapes. Moi-même, je permettais à chacun de qualifier à la fois son ressentiment et de qualifier sa demande vis à vis de l’autre, je faisais l’anamnèse, ensuite je cherchais des personnes influentes les unes auprès des autres. Je travaillais dans une idée de réseau, c’est-à-dire, je vais pas rester le chevalier blanc auquel chacun va s’adresser. Mon idée, c’est qu’une fois que chacun va avancer dans l’élucidation de ce qu’ils veulent, et l’élucidation du ressentiment qu’ils ont, je cherche des personnes influentes et des personnes relais. Et ensuite, j’essais de trouver avec les uns et avec les autres, on cherche un dispositif médiateur. Par exemple là, le dispositif médiateur qu’on avait trouvé, c’est de dire « il faudrait se mettre autour d’une table ». Donc j’ai dit « créons la table », donc on va imaginer un observatoire de l’enfance en danger au niveau départemental, si on crée un observatoire, s’y retrouveront les gens du tribunal, les gens du conseil général, les gens de la préfecture mais de manière ritualisée, de manière instituée. C’est cet institué là nouveau qui va faire médiation. SI on avait dit, « il faut se mettre d’accord » sans trouver l’institué par lequel on allait se mettre d’accord, ça ne marchait pas parce que chacun disait, « c’est pas à nous de faire le premier pas pour qu’on se mette d’accord », chaque partie disant « c’est à eux de faire le premier pas, c’est pas moi qui vait provoquer une réunion ». Une fois qu’on a trouvé l’institutionnel ou l’institué, plus personne ne disait « c’est à l’autre de venir », on se retrouve dans l’observatoire et ce faisant, on va essayer, on va se rendre compte de ce qu’on peut se demander les uns aux autres, chacun dans une contribution, qui doit être la sienne d’un point de vue institutionnel, à la protection de l’enfance. Donc c’est bien l’intérêt commun qui ressurgit « la protection de l’enfance », au-delà des préventions que chacun peut avoir, les uns disant, ils veulent nous imposer des dispositifs tout faits, les autres disant, on est autant conscient qu’eux de la protection de l’enfance mais ils veulent nous imposer à nous qui devons payer des dispositifs tous faits sans réfléchir aux incidences financières et à notre obligation de bonne gestion de l’argent public, ils ne veulent même pas réfléchir à ça. Donc il fallait pouvoir examiner le bien fondé de ce préjugé là. Est-ce que c’est vrai qu’ils veulent vous imposer des dispositifs ? Et pour les autres, la justice, c’était de dire « nous en droit, on décide de mesures éducatives qui nous paraissent pertinentes, en droit c’est à eux de financer ces mesures, on ne veut pas leur imposer des dispositifs mais on veut que nos mesures soient mises en œuvre. Ce faisant tout le monde se retrouvant autour d’une table au nom d’un bien commun « la protection de l’enfance », finalement, ils ont réussi à trouver des solutions et des compromis.
Les éléments essentiels de méthode seraient le fait qu’on puisse reconnaître le conflit ou le différend. C’est difficile de reconnaître le différend, ils ne disaient pas qu’ils étaient en conflit, mais le secrétaire général disait « vous savez moi quand on me parle sur ce ton, je ne fais plus rien », en parlant des juges qui lui envoyaient des lettres incendiaires. Moi-même , je me gardais bien de dire qu’ils étaient en conflit, mais ils ont des cultures, des valeurs, et puis surtout , ils ont des a priori sur la façon dont les autres les voient. Elucider la façon dont les autres les voient, ça fait partie du travail de médiateur.
Autre exemple : une médiation « mine de rien »
Au cours d’un séminaire qui réunissait les directeurs de foyers réunissant des personnes handicapées. Le foyer est un endroit ou vivent les personnes handicapées. Association nationale régionalisée avec plusieurs établissement. Dans chaque région un directeur régional et un directeur par foyer. Une fois par an , il y a un séminaire qui réunit tous les directeurs avec le directeur général. J’avais été convié pour faciliter les débats. Quand le séminaire a commencé, il y avait une femme qui avait l’air très mécontente. Le directeur général m’en avait dit deux mots. On se réunit et la dame était en face de moi avec des yeux assassins et j’ai senti qu’on ne pouvait pas commencer le séminaire comme ça, passer par-dessus la méchante humeur qui la caractérisait. Je dis à cette dame, » je vois que vous avez l’air en colère », donc si vous voulez, dites-nous ce qui ne va pas. Et elle m’a répondu , « le monsieur qui est à côté de vous (le directeur général) n’a pas de cœur, c’est un homme sans cœur ». Je dis « comment ça se fait que vous dites ça ? » et elle dit « parce qu’il m’a obligé par lettre recommandée avec accusé de réception, à venir à ce séminaire ». Je dis « comment ça se fait qu’il vous a obligé à venir à ce séminaire de cette manière là, même si c’était une obligation pour tout le monde ? » Elle dit : « mais parce qu’il y a une de mes résidentes qui est décédée, or ce n’est pas n’importe laquelle, on la connaît depuis 15 ans et de plus elle s’est elle-même donné la mort parce qu’elle a arrêté de se nourrir depuis 2 mois, toute l’équipe a lutté pour que ce ne soit pas comme ça et on a perdu ce combat, donc on a été tous très affectés, et moi la première.Je ne pouvais pas imaginer me faire représenter à cet enterrement parce que pour moi, ce n’est pas une histoire de représentation, j’ai besoin moi d’aller à cet enterrement là. Or Monsieur le directeur pensait que je pouvais simplement me faire représenter et c’est pourquoi il m’a convoqué de manière autoritaire à ce séminaire ». Donc là, j’ai dit au Monsieur, « manifestement madame est très en colère contre ça, et qu’est-ce qui pour vous a pu justifier cette manière autoritaire de faire ? ». Il m’a dit, « mais ce séminaire a beaucoup d’importance, nous n’en avons qu’un par an, et je trouve qu’une fois de plus, elle n’aurait pas participé à nos discussions, et une fois de plus elle mène son affaire seule dans son coin sans prendre en compte le collectif qu’on représente ». Ensuite, je les ai fait parler l’un l’autre et je les ai invités à dire comment ils interprétaient ce que l’autre disait, puis j’ai proposé un détour de réflexion sur la tyrannie et sur les actions tyranniques , c’est à dire vous vous avez considéré la décision du directeur comme un acte tyrannique, Est-ce que vous vous l’avez vous-même imaginé comme un acte tyrannique ? c’est à dire qui doit emporter l’action et la décision de l’autre sans son consentement ? On ne s’occupe pas du consentement de l’autre. A la fin de la réflexion à laquelle tout le monde a contribué, on a fait une pause et je leur ai proposé d’aller discuter tout seuls, et ils se sont mis d’accord, finalement elle s’est absentée pour se rendre à l’enterrement et elle est revenue au séminaire.
Est-ce qu’on pourrait dire que ce décalage fait partie de ta méthode ?
Oui, c’est sur. A la fois c’est pas un décalage immédiat. Des fois c’est par là que je commence, mais là ça ne pouvait pas être par là que j’allais commencer. Effectivement à un moment donné, ça fait une espèce de rupture, on se décolle du problème et on se met à réfléchir sur des valeurs communes, des intentions, sur un sens. Je ne pouvais pas commencer par là parce qu’il fallait que je traite les affects, il fallait qu’on s’occupe de la colère de la dame, il fallait qu’on s’occupe de la position haute et hiérarchique du Monsieur. Et il fallait aussi qu’ils s’entendent un peu l’un l’autre et ça c’était l’occasion que je pouvais leur donner parce qu’à eux deux ils ne pouvaient pas s’entendre l’un l’autre, parce qu’ils étaient trop en ressentiment et en prévention vis à vis de l’autre.
Là j’ai fait l’anamnèse, je les ai amenés à élucider la représentation qu’ils avaient des intentions de l’autre. Les procès d’intention en fait. Il fallait qu’on explicite et qu’on élucide les procès d’intention respectifs. Si elle ne vient pas c’est qu’un fois de plus elle ne veut pas participer à nos réunions et que comme ça , elle continue d’agir seule dans son coin et de faire comme si elle ne faisait pas partie d’un ensemble. C’était le procès d’intention, pas tout à fait faux d’ailleurs. Seulement la réaction sur cet événement là était probablement inopportune mais elle aura servi à se mettre d’accord sur les modes de participation mutuels. Et elle aura servi à se mettre d’accord, sur la limite de l’autorité des uns et des autres, c’est-à-dire « sur quoi peut jouer l’autorité d’un directeur ou d’un responsable, sur quoi elle joue et à un moment donné, finalement comment tu fais quand même avec le libre arbitre ou la volonté de celui que tu commandes ? C’était ça après la réflexion. Commander à l’autre, c’est commander dans un certain contexte, dans certaines limites et dans un territoire de prérogatives. Quand on est hiérarchique, on est jamais hiérarchique de la personne, on est hiérarchique de la fonction.
A quel moment est-ce que tu as senti que tu pouvais leur proposer d’aller discuter tous les deux ?
A partir du moment où ils avaient contribué comme les autres, l’un et l’autre à la réflexion. Je me suis dit « ça y est, ils ont lâché ». C’est un peu intuitif cette affaire là. Je les sentais contribuer à la réflexion comme les autres, puis…c’était l’heure de la pause.
Quel est le rôle de ton ressenti dans la médiation ?
Je pense que c’est une histoire d’empathie. J’éprouve la situation conflictuelle quand le niveau d’acrimonie, d’inquiétude est un haut niveau et je l’éprouve quand il a baissé quand il s’est calmé. Je pense que c’est ça, il y a une histoire d’empathie.
C’est avec ça que j’anime tout le temps, que je dis « on a pas parlé de ça mais il vaut mieux que j’arrête d’en parler parce que là je sens le niveau de tension ou de dispersion ». J’éprouve avec eux.
Est-ce que tu l’amène comme thème ?
NON. Si, quand je dis « je sens que vous êtes en colère » oui, je l’amène comme thème.
Pourquoi est-ce que ton NON est si catégorique ?
Parce que j’ai trop assisté, j’ai vu trop de formateurs faire leur commerce de leurs propres projections sentimentales, affectives, etc. sur un groupe et même poser, s’éterniser dans le « ce qu’on ressent en ce moment « comment on a vécu ça, etc. et moi je trouve que c’est intéressant, d’être en alerte…mais l’empathie c’est une histoire d’humanité et de rapport avec l’autre, c’est un rapport de l’homme à l’homme. Ca fait partie de nos ressorts. Ca pourrait se développer mais en stage …
J’ai partagé la difficulté dans laquelle cette femme se trouvait et j’ai partagé aussi la difficulté dans laquelle cet homme se trouvait d’être pris en défaut à ce point là, parce qu’il risquait de perdre la face aux yeux de tout un groupe. La clé : si j’avais dit « parlons de votre tyrannie », ce n’était pas tout à fait pareil de dire « parlons des actes tyranniques » et en reconnaissant le caractère tyrannique de l’acte, ce faisant, je faisais ce travail de discrimination qui faisait que cet homme là n’était pas un tyran. Donc pour moi, il y avait une stratégie quand même. Je permettais à la fois une reconnaissance et une attestation, quelque chose qui dépasse largement un commandement qui s’adresserait à une volonté libre et en même temps si on réduit cet homme là quand elle disait-il n’a pas de cœur, je sentais qu’elle pouvait réduire l’homme dans sa totalité à ça. En me mettant à réfléchir avec eux sur un acte tyrannique, finalement j’isolais la question.
Comment toucher avec la raison à quelque chose qui justement n’est pas du côté de la raison ?
IL n’y a pas de raison qui soit désaffectée.
IL faut aimer. C’est pas une conséquence, c’est une cause d’aimer. C’est l’histoire de « pessimiser » les affects.
Qu’est-ce qui n’est pas réductible à une méthode, c’est l’empathie et je pense que c’est peut être aussi l’esprit dans lequel tu fais ta médiation ? Quel esprit est-ce que tu adoptes ? Dans quoi tu te mets ? Qu’est-ce que tu penses sur les gens qui sont là, sur le monde en général ?
Un esprit humaniste. Cela se résume en une phrase simple « l’homme ne se réduit pas à ce qui se manifeste de lui ». « Même l’assassin n’est pas qu’un assassin ». Permettre à chacun d’accéder à une autre part ou une autre dimension de l’autre à la fois c’est un moyen et une fin. Parce que si j’accède à une autre part de l’autre, là je vais peut être trouver ce par quoi nous allons échapper de concert à notre différend, le résoudre, c’est-à-dire qu’on va se donner matière parce qu’on accède à d’autres dimensions de l’autre, on va se donner matière, c’est un moyen. Et c’est une fin parce que ça veut dire que justement, l’autre sujet ne se réduit pas…c’est l’histoire de la phrase de Kant qui a ordonné notre conception morale du monde c’est « tu ne prendras pas l’autre seulement pour un moyen mais aussi pour une fin ». Peut-être je suis un peu kantien là dedans. L’esprit c’est ça, par principe, ce n’est pas possible que de toute manière l’autre se réduise à ce qui fait obstacle à la rencontre. IL ne se réduit pas à ce qui se manifeste de lui. Il y a un travail de comment est-ce qu’on attire l’autre du côté de sa richesse. Comment on fait sortir l’autre de sa pauvreté. C’est pas qu’il n’est pas pauvre, ou qu’il ne se manifeste pas comme pauvre, c’est pas qu’il est pas menteur, qu’il est pas de mauvaise fois, archi égoïste, c’est pas qu’il n’a pas d’intention de nuire, peut être qu’il est tout cela..je ne le nie pas et ça m’intéresse même de le reconnaître, mais ce faisant, c’est ce que je propose, ce vers quoi j’essaye de conduire chacun. Une fois reconnue cette dimension là, allons voir les autres dimensions qui nous feront sortir de celle-là.
Ca est-ce que tu le poses, quand tu animes un séminaire sur la médiation ?
Non. Je fais beaucoup de choses secrètement. Parce qu’il me semble que la conscience…tu n’ordonnes pas un dialogue fécond, riche, écoutant des uns et des autres, intensif, sensé, etc. parce que tu dis « je veux que ce soit écoutant, riche, etc. ». Ca dépend, si je fais une formation à la médiation, je pense que j’explicite ce principe là.
Je pars du principe que l’empathie existe pour tout le monde seulement il y a des couches parfois qui protègent. Ca fait partie de l’homme, de l’humanité. La question c’est qu’est-ce qu’on va « pessimiser » pour que ça soit optimisé ? Ca serait une bonne question.
Développer son empathie c’est pas compliqué…évidemment si t’es bourré de trouille, de peur, ça empèche d’être empathique. Moi si je ne ramasse pas un clochard , c’est parce que j’ai la trouille..
Donc tu amènes la peur alors dans la médiation…le rôle de la peur…
Je pourrais amener le rôle de la peur, le rôle des affects, le rôle des codes sociaux aussi…qu’est-ce qui fait que tu ramasses pas un clochard dans la rue ?
C’est sur peut-être que ça fait partie du travail, de redonner la possibilité à l’empathie de s’exprimer. Il faut que j’éprouve quelque chose pour l’autre pour avoir envie de faire des compromis. Alors éprouver quelque chose pour son bourreau c’est compliqué. Et je peux éprouver quelque chose pour mon bourreau si je le vois autrement que comme un bourreau, et comment faire pour le voir autrement que comme un bourreau, parce qu’on va parler d’autre chose ensemble que la médiation provoque. Cette parole là sur autre chose. Il n’y a pas la relation, mais il y a un contenu qui va recréer de la relation. Et c’est ce à quoi sert un médiateur. Lui peut aborder d’autres sujets, alors que les gens qui sont dans leur histoire n’ont qu’un sujet en tête, ils sont obnubilés, ils sont obsédés. On peut même dire qu’il y a quelque chose de l’ordre du prestidigitateur chez le médiateur.
Le prestidigitateur :
Le propre du prestidigitateur, c’est de t’empêcher de voir le coup qu’il est en train de faire parce qu’il attire ton attention ailleurs. C’est pas qu’il est particulièrement doué pour ne pas que ça se voit dans le geste. Tu sais quand il planque une carte, un mouchoir. Il est particulièrement doué pour emporter ton attention ailleurs que là ou tu pourrais voir. Si ton attention restait là, tu verrais. Peut être qu’un médiateur emmène l’attention ailleurs, mine de rien. Et tu veux que je dévoile ma méthode, ça va pas la tête ?
Probablement, même quand je fais une formation à la médiation ,je fais de la médiation, donc il y a un truc…Si tu mets à jour tous les ressorts, il n’y a plus médiation. Ma méthode pédagogique est déjà une méthode de médiation, c’est-à-dire relier des cerveaux, relier des sensibilités, des raisons, des cadres de référence, les mettre en résonance, en dialogue, etc. Mais ce faisant c’est parce que si je détourne à leur insu les participants de zones de crispation trop grandes, de quant à soi, de centrations sur leur ego, c’est parce que je les détourne que ça fonctionne (parfois pose une question comme ça qui n’a rien à voir et le groupe se met à réfléchir la-dessus ex : est-ce que vous doutez ? et donc ils ne sont pas du tout dans la même crispation que juste avant parce que tout à coup, il fait une digression, il se met à parler d’autre chose…).
La pêche à la ligne :
Il y a dans la médiation, un art de la pêche à la ligne (comme dirait Ouaknin). Pour pêcher à la ligne, il faut avoir un hameçon et un appât et suffisamment de fil pour aller chercher des fois loin et un moulinet pour aller chercher des fois tout près . L’appât c’est « tiens et si on parlait de ça » et ça leur plait qu’on parle de ça, ça attire. L’hameçon, c’est la question, certaines questions on y reste accroché. Il y a des questions auxquelles on reste accrochés, donc ce qui m’intéresse, c’est pas qu’on me réponde à ma question, mais c’est que l’autre se pose la question que je lui pose. Il y a une nuance fondamentale. Tu comprends ? Quand je pose une question , parfois l’autre à seulement à y répondre et d’autres questions, l’autre a à se la poser pour y répondre . C’est ça l’hameçon, il reste accroché, et tout le temps ou il reste accroché est un temps de suspension, c’est un temps de paralysie de l’action. C’est ça le nid de la réflexion. Voilà, c’est ça la méthode !
La caresse :
Ca consiste à éveiller l’autre à lui-même, sans savoir où on l’emmène. Un médiateur qui sait à quelle solution il faut arriver est foutu. Il ne peut pas retenir ça. Il caresse pour aller…tu vois. Il a déjà un plan. Non. La caresse qui éveille l’autre à lui-même, qui n’est pas une prise de possession. Quand quelqu’un te dit, mais de toute manière, c’est un con ou nous ce qu’on veut c’est ça. Eveiller l’autre à lui-même, ça veut dire que tu vas t’étonner de ce qu’il dit. C’est le travail de l’étonnement. C’est ni je rejette, ni j’étouffe, Même si je sais que c’est ailleurs que je veux aller, ni j’accrédite …en disant oui, c’est vrai c’est un con. Donc c’est ni…ni…ni…Ce que tu fais c’est la caresse, c’est l’hospitalité, t’accueille et tu dis à l’autre « quand tu dis ça qu’est-ce que tu dis ? Quand tu dis ça qu’est-ce que tu veux ? Quand tu dis ça qu’est-ce que tu crois ? Qu’est-ce que ça a comme conséquences de dire une chose pareille ? C’est-à-dire que t’amène l’autre à examiner ce qu’il dit. Par tes questions, il se pose des questions sur ce qu’il dit. D’une certaine manière, t’amène l’autre et devant l’autre, à se distinguer lui de ce qu’il dit. Il n’est pas ce qu’il dit et il n’a pas besoin d’ailleurs de se justifier lui-même , il a besoin lui de venir examiner ce qu’il dit, ce qui n’est pas la même chose. Il n’est pas réductible à ce qu’il dit parce que tu prends, tu te saisis de ce qu’il dit comme d’un objet, mais lui n’est pas un objet. Parce que lui, tu le reconnais comme capable de dire ça et de dire autre chose. Tu le reconnais comme capable de changer d’avis, tu le reconnais comme capable de se sortir de sa propre idée. Lui est sujet, donc à l’origine, il est auteur de ce qu’il dit, on ne va pas dire le contraire, mais il est auteur aussi du devenir possible de ce qu’il va dire et c’est ça que tu travailles. Tu dis, là attendez, vous avez dit ça , et alors…comment vous comprenez..vous ce qu’il a dit ? Comment vous interprétez ce qu’il a dit ? Ah, donc comment vous comprenez ce qu’il a dit, c’est ce petit jeu là, comment vous interprétez, comment vous comprenez, ce petit jeu là aussi est un jeu de distinction. C’est comme.. ;c’est quoi ma recouvrante…c’est quoi ma couverture. C’est difficile d’avoir une écoute découvrante, on a toujours une attitude recouvrante. Le médiateur il établit, fonde la possibilité d’une écoute découvrante. C’est ça la caresse. La caresse se joue toujours dans cette histoire de recouvrir, découvir. Au moment de la caresse, il y a comme ça un peu de recouvrant, et en même temps cela se nourrit de la nudité. C’est ça qui est intéressant.
A quel moment est-ce que tu reformules ?
J’aime pas ce mot là reformuler. C’est pas un joli mot. Ca voudrait dire mettre en formules, ce que je voudrais, c’est que plus chacun parle en formule, c’est-à-dire en message sensé faire clé, en élément de démonstration, c’est-à-dire en prédicat, en principe, etc… Si je reformule, c’est comme si j’en rajoutais une couche sur le caractère démonstratif de la parole.
La question c’est reprendre la parole. C’est ça tout le travail du médiateur, quand il reprend, il trie, et il restitue, il prête des mots. C’est un prêteur de mots. SI je dis ça comme ça, par exemple si l’autre me parle de tyrannie et l’autre me parle d’un acte de tyrannie. Est-ce que j’ai reformulé ? non, j’ai pas reformulé, je me suis saisi de son idée, et je lui prête des mots supplémentaires ?
C’est quoi la transition, juste avant de lui prêter le mot ? C’est quoi la transition intérieure que tu fais là ?
Là il y a un travail de transformation…
Ce travail d’altérité sur le propos, avec la pensée de l’autre, c’est pas un travail de reformulation, justement.
Ce qui me permet de faire ce travail de transformation…c’est parce que je pense avec, c’est parce que c’est de la co-pensée, de la co-production, de la co-réflexion. J’en sais pas plus que lui, je pense avec eux, ils sont en train d’essayer de résoudre un problème, j’en sais pas plus qu’eux sur le problème. Ils sont en trains de parler d’une affaire, je n’en sais pas plus, seulement, ce que je sais quand même c’est que dès qu’on parle de quelque chose qui nous touche, qui nous affecte, on a tendance quand même, effectivement à avoir des formules, des condensés de signification, donc j’essaye de proposer finalement des nuances alternatives , si on peut dire. Un exemple, et là c’est vraiment un travail sur le vocabulaire et l’extension du vocabulaire. Une extension du lexique, finalement, c’est pas sur que celui qui parle n’a pas accès immédiatement, à un lexique suffisamment étendu pour énoncer et pour penser ce qu’il veut dire. Je présuppose ça. Donc j’essaye sans cesse de lui faire des propositions qui ne sont pas des injonctions. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parce que parfois j’ai trop envie de recouvrir, mais si je fais vraiment ce travail rigoureux, exigeant, je ne peux pas proposer une extension lexicale à l’autre pour lui créer son orientation, mais je vais lui proposer une extension lexicale pour qu’il ait désormais à sa disposition un choix de qualification possible qui lui permettront de repenser ce qu’il est en train de dire. Ca c’est fondamental. On est prêteur de mots, qui permettent d’exprimer l’idée avec plus de nuance, voire de développer l’idée.
J’ai l’impression qu’on en revient au texte que tu as lu sur la violence des mots …
Oui, qu’est-ce qui fait la violence des mots, justement…parce qu’il disait que quand les mots font violence, souvent ,il s sont dans un registre lexical très étroit. Les mots font beaucoup moins violence quand on étend le registre. D’ailleurs, le discours, d’Hitler, le discours de Le Pen…tous ces discours, c’est toujours dans un registre lexical extrêmement étroit. Bien sur, qu’à l’instant même ou tu proposes comme ça un nuancier lexical, finalement tu induis de l’apaisement, en tous cas, tu mets un terme provisoire à la violence des mots. « Vous avez dit : ils vous méprisent… » j’essaye de voir à quoi ça correspond, quand on dit ça de quelqu’un. Des fois on a à faire à l’indifférence, des fois, on a à faire à un ton hautain, des fois on a à faire à une forme, à une totale absence d’écoute, l’autre ne reprend pas ce que je dis, il parle toujours ailleurs, il parle toujours de son centre à lui, de son ailleurs à lui. Des fois, dire qu’on se sent méprisé, c’est aussi vouloir dire qu’on ne se sent pas à la hauteur. Si je dis ça à celui qui dit, « il me méprise », et si celui qui est sensé mépriser est là, à lui aussi, je propose de l’apaisement, parce que ce n’est plus de la violence des mots, c’est une recherche de sens. Ca fait médiation, parce que ça fait médiation par l’extension du vocabulaire.
Quel lien est-ce que tu peux faire entre l’anamnèse et l’extension du champ lexical ?
Même le médecin étend ton champ lexical pour que tu puisses parler de ton mal. Quel genre de mal , C’est plutôt en crise spasmodique ? Ce sont des spasmes ? c’est-à-dire ça vient comme ça par à coup ou c’est continu. Ca vient par à coup …c‘est spasmodique. C’est plutôt chronique ? Ca fait un bout de temps que ça se répète, c’est pas en continu..
Dans l’anamnèse, il y a aussi un prêt de vocabulaire, une extension du champ lexical, et ce faisant c’est pas seulement qu’on agrandit son vocabulaire et qu’on fait de la culture. Mais que ce faisant, on permet de réfléchir, de penser, on est pas assailli par la chose, la chose devient mots. Et ce sont plus justement les mots qui sont réduits à la chose, c’est ça le mot violent. C’est quand les mots sont réduits à la chose, les mots sont réduits à la haine, les mots sont réduits à mon envie de meurtre et en général, ils sont très pauvres. Mais du coup, on inverse la machine, et grâce à cette extension là finalement, on va d’une certaine manière résoudre la chose dans les mots. Ca fait médiation.
L’anamnèse y participe, mais pas seulement. L’anamnèse serait cette possibilité de revenir au plus près possible des événements, des phénomènes, des faits. On ne s’occupe pas que des faits, on s’occupe aussi des visions. On s’occupe aussi des procès d’intention, des interprétations. L’anamnèse c’est la part faite au récit. On transforme l’autre en conteur. Raconte-moi ton histoire, raconte-moi, fais-moi un récit. Mais si je dis anamnèse, je prive l’autre…Je vais peut-être supprimer le mot anamnèse, je pense qu’il est pas très juste parce que si je dis anamnèse, je crois que je prive l’autre d’une puissance métaphorique. Avec le récit, il y a toujours, une puissance métaphorique, une énergie métaphorique. Quand on dit à l’autre raconte-moi ton histoire, qu’est-ce qui s’est passé, toi t’étais quoi là dedans ? qu’est-ce qui t’es arrivé, fais –moi le récit ? on transforme l’autre en conteur. Dans l’anamnèse peut-être qu’on « hiératise » un peu les choses, on les rétrécit. On les localise, on les distingue, on les discrimine, on les place, on les positionne mais on ne les « métaphorise » pas…ou alors il y a les deux. Il y a le temps de l’anamnèse et il y a le temps du récit, comme il y a le temps des visions, comme il y a le temps des prévisions.
Je pense parfois qu’il vaut mieux commencer par le récit, et prendre à l’intérieur du récit, des passages, des actions et là pratiquer cette forme d’anamnèse pour re-libérer du mythe. Le récit c’est la confirmation du mythe. Il y a un mythe qui s’est créé, et en même temps si on fait comme s’il n’y avait pas de mythe… Quand les comoriens me disent, « ils nous méprisent », il y a vraiment un mythe qui s’est crée autour des habitants des grandes Comores. Et le récit sera le récit d’une épopée ou on aura enjolivé, on aura raccordé des témoignages qui ne se raccordaient pas en réalité mais qui viennent constituer la réalité de ce sentiment là…conforter comme ça cette vision et cette projection qu’on fait sur les autres. En même temps le récit, ça reconnaît celui qui le raconte comme un héros. Ca peut être un héros subsidiaire, mais quand même c’est forcément un héros, il y est pour quelque chose, ça m’intéresse beaucoup de donner la place au récit, au mythe et au conte.
« Racontez-moi » évidement c’est pas pareil que si on dit « dites-moi ce qui s’est passé », ou dites-moi ce que vous en pensez…Il y a une puissance métaphorique dans ces ingrédients universels du récit, qui sont le héros, sa quête, ses empêchements et puis ses attributs. Et c’est très intéressant de dire ça, parce qu’on peut aussi même empêcher d’aller jusqu’au bout, le héros reste un héros, mais il reste un héros à la mesure de toutes les dépenses, de toutes les tentatives qu’il a faites pour arriver jusqu’à sa quête. Ca m’intéresse de cherche à travers ça les tentatives de solutions. Comment on a essayé de se sortir du problème. C’est pas possible qu’on soit resté les bras ballants. Or c’est comme on a essayé de se sortir du problème qui a fait problème, souvent qui a alimenté le problème. Quia renvoyé à l’autre matière à se renforcer dans sa position. Quand on suscite un récit, finalement on fait dire la place du héros, on fait dire ce qu’il a tenté, on fait dire ses empêchements, on fait dire ce à quoi il tient, ce à quoi il tenait, et donc là encore on étend considérablement la matière à propos de laquelle il va pouvoir y avoir dialogue et discussion. Tant qu’on reste centré sur le problème, sur les effets du problème, sur les conséquences susceptibles d’advenir, tant qu’on reste centré la-dessus, on a pas assez de matière pour discuter.
On est un peu comme le cuisinier avec sa pâte, qui étend la boule, Deleuze disait « le pli, le plan, le mouvement » une espèce de trilogie comme ça. On va dans les plis et chaque fois qu’on trouve un pli, on fait un plan, on étend la matière. Chaque fois qu’on a fait un plan on a matière à rebondir peut-être sur un autre plan, sur une autre strate.
Ca m’intéresserait qu’on développe plus la dimension philosophique de la médiation. Faire médiation, c’est instituer un pensoir. J’aimerais bien qu’on développe ça.
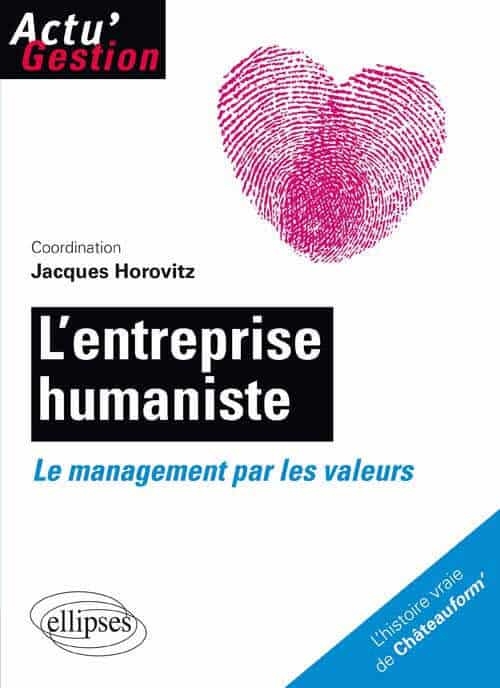
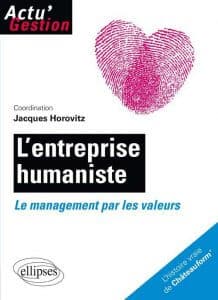
L’ouvrage écrit par plusieurs auteurs répond à une question essentielle, à savoir Qu’est-ce qu’une entreprise humaniste : Selon ce collectif dirigé par Jacques Horovitz.
Il s’agit «d’une entreprise qui a fait le choix du management par les valeurs plutôt que par les règles, et qui met les hommes et les femmes au coeur de l’entreprise au lieu de la performance».
Les auteurs décortiquent cette thèse et dévoilent les clés pour mieux appréhender cette notion. 26 consultants, en l’occurrence Frédéric Beaud Bernard Benattar Michel Calef Sandra Chauvin Véronique Cherki Philippe Cosson Pierre Daems Nicole Danon Stéphane Flahaut Hervé Franceschi Olivier Herold Pierre-Arnaud Juin Victoire Lejuste Régine Lepage Claire Lustig-Rochet Patrick Minod Béatrice de la Perrelle Agnès Poirier Jocelyn Rémy Martine Renaud-Boulart Brigitte Romagné Étienne Roy Sandra Sadat Annie Sarthe-Innocenti Édouard Stacke Gill Webb ont rédigé cette oeuvre. Tous sont sensibles à une nouvelle forme de management.
Etayé par exemples concrets d’expériences réussies, les auteurs démontrent les avantages de ce nouveau type de management. C’est bien dans cette optique que Jacques Horovitz met en exergue les pratiques mises en place chez Châteauform, une entreprise atypique qui offre des sites entièrement dédiés aux séminaires d’entreprise avec un accueil «comme à la maison». Bref, l’ouvrage est destiné à toutes les populations des managers en passant par les responsables RH ou encore les étudiants. Tous pourront découvrir les limites du management classique.
Diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris et de l’Université de Columbia, Jacques Horovitz enseigne le management, la stratégie de service et marketing à l’IMD, Institut for management development, Lausanne, Suisse (en 2014). Il est aussi président-fondateur de «Châteauform» the home of seminars (1996) qui est positionné dans la transformation et la rénovation de demeures historiques pour la réception de séminaires d’entreprise.
Ed. Broché
(2 janvier 2013)

Bertrand-Baptiste Hagenmüller a reçu un cadeau de la part des organisateurs de « Belle, la différence ! ».
Le festival « Belle, la différence ! » autour du cinéma et du handicap qui s’est tenu durant quatre jours au cinéma Le Fauteuil Rouge a rendu son palmarès.
La co-présidente, Dominique Beaujault-Gris, retiendra des « témoignages d’espoir et d’amour ». Bertrand-Baptiste Hagenmüller, président du jury, a pris « beaucoup de plaisir au sein d’un jury qui reflétait exactement le titre du festival ». Il a aussi rajouté que « le cinéma pouvait aider le handicap à sortir des murs ». Frédéric Arnaud, directeur du Fauteuil Rouge, s’avouait satisfait. « Nous sommes montés de deux ou trois étages avec cette 2e édition. Un remerciement tout particulier à Harold Manning, notre animateur durant l’édition. » Environ 1.300 personnes ont fréquenté le cinéma durant le festival.
Palmarès : prix d’interprétation féminine à Kaarina Hazard pour son rôle dans « Lettres au père Jacob » ; prix d’interprétation masculine à Thomas Blanchard pour son rôle dans « Préjudice » ; prix du meilleur scénario à « Préjudice », d’Antoine Cuypers ; prix du jury (unanimité) à « Classe à part », d’Ivan Tverdovsky ; prix du meilleur documentaire à « J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd », de Lætitia Carton et prix du public décerné au film d’Eric Besnard, « Le Goût des Merveilles ».
Source : La Nouvelle République (26/09/2016)

D’un côté on ne cesse de valoriser la participation des habitants comme solution à la plupart des problèmes, de l’autre on ne peut qu’observer la difficulté des professionnels à mettre en œuvre concrètement cette participation. Comment, dès lors, interpréter l’écart entre les discours et les pratiques, quels sont les freins qui empêchent de passer de la parole aux actes.
1. La « demande » de participation : une évolution sociétale majeure
On observe dans nos sociétés occidentales un puissant mouvement de « désinstitutionalisation » qui rend de plus en plus insupportable l’imposition de décisions « par le haut ». Pendant longtemps les « institutions » ont été considérées comme détentrices d’un pouvoir légitime, de telle manière que l’autorité de ses représentants (des travailleurs sociaux pour ce qui nous occupe) ne reposait pas tant sur les qualités de ces derniers que sur le simple fait qu’ils incarnaient l’institution. Désormais la légitimité de l’autorité ne semble plus obéir au même ressort. Pour considérer une décision comme « légitime » nous exigeons : la reconnaissance (« je veux qu’on me prenne en considération, qu’on m’entende en tant qu’acteur et Sujet ») et la transparence (« je veux que l’on m’explique pourquoi les choses se font de telle manière »). En un mot je veux être « associé », « participer » aux décisions qui me concerne. Dès lors le mépris et l’arbitraire nous apparaissent comme des pratiques intolérables dans la mesure où elles nous dénient le droit d’être considérés comme des Sujets.
C’est dans ce contexte que la participation est devenue un enjeu majeur dans le travail social, que ce soit en individuel, via la contractualisation, ou en collectif, via les Conseils de la Vie Social ou les actions collectives par exemple ; les lois votées à ce sujet attestant clairement ce mouvement de société (on pense par exemple à la loi 2002-2 dans le social et le médico-social). Mais alors pourquoi la participation des habitants, qui fait l’objet d’un fort consensus chez les professionnels et les « politiques », est dans les faits si peu mise en œuvre ? Autrement dit quels sont les principaux freins à l’instauration effective de cette pratique ?
2. Les freins à la mise en œuvre effective de la participation
Pour tenter de répondre à cette question je me référerai principalement au champ dans lequel je travaille, c’est-à-dire celui de l’intervention collective dans le secteur du social.
Place du professionnel et participation
Que reste-t-il du patronage ?
Pour ce qui relève de la mise en place d’actions collectives, il n’est pas rare qu’en tant que professionnels nous choisissions de transmettre ou de ne pas transmettre une information à un usager ou que nous décidions d’impliquer les habitants dans la construction du projet ou, au contraire, de les tenir à l’écart, parce que dit-on : « ça ne les intéressera pas », « ça va créer de la confusion » ou encore « les usagers ont d’autres choses à penser étant donner leur situation ». Ce faisant nous nous plaçons en protecteurs des intérêts des usagers, et « pour leur bien » nous décidons seul. Bien sûr, ce raisonnement se justifie dans certains cas, mais son caractère récurrent confère à une forme d’infantilisation des usagers qui n’est pas sans rappeler l’esprit du paternalisme défini par le Petit Robert comme « la tendance à imposer un contrôle, une domination, sous couvert de protection ». Mettre en œuvre une participation effective suppose de rompre avec ce type de pratique et de se donner comme objectif transversal, du moins dans les projets d’actions collectives, de permettre aux gens de (re)trouver de pouvoir sur leur réalité sociale, familiale ou individuelle … mais donner plus de pouvoir aux usagers-habitants, n’est-ce pas risquer d’en perdre en tant que professionnel ?
L’usager ou l’Autre (social)
Le deuxième élément qu’il faut prendre en compte c’est que la mise en place d’une participation réelle est souvent facteur d’incertitude et donc d’anxiété chez les professionnels. Dès lors que l’usager n’est plus considéré comme uniquement destinataire de l’action mais aussi comme acteur, il est impératif qu’il participe à l’élaboration des projets. Les professionnels sont de ce fait acculés à sortir de « l’entre soi » et il devient impossible de « ficeler » un projet dans le huit clos des salles de réunions, entre personnes partageant les mêmes représentations et le même habitus de classe … il faut désormais tenir compte de l’habitant ! Cette apparition vient soulever de nombreuses interrogations : « Si les usagers ont la même place que moi dans la construction du projet, quelle est ma plus-value de professionnel ? Comment s’adapter aux besoins toujours changeant des usagers ?… ». L’usager-habitant amène de l’incertitude par ce qu’il est (souvent issu d’une catégorie sociale ou ethnique qui n’est pas la nôtre), et par ce qu’il veut (difficile de concilier objectifs professionnels et champ d’expérience de l’habitant). L’usager c’est « l’Autre » et en particulier « l’Autre social » … l’Autre c’est l’incertitude … et l’incertitude est anxiogène !
La mobilisation collective : « c’est bien mais ce n’est pas l’essentiel »
Les actions collectives et la mobilisation collective est encore aujourd’hui considérée chez bon nombre de professionnels comme des actions intéressantes certes mais secondaires au double sens du terme :
– Elles seraient secondaires pour les gens … leur priorité étant de résoudre leurs problèmes financiers (tout se passe comme si la réflexion à ce sujet s’était bloquée dans les années 40 avec la sacro-sainte « pyramide de Maslow »)
– Elles sont secondaires pour les professionnels : le « vrai » travail étant l’intervention individuelle
Une idéalisation de la notion de « participation »
L’image du citoyen « modèle »
Il me semble que la manière dont la tradition française envisage la participation freine considérablement sa mise en œuvre. Dans notre imaginaire collectif la participation est celle du « citoyen » perçu comme un modèle d’engagement dans l’espace public, sorte de premier de la classe, poli, intelligent, clair, assidu et disponible … alors forcément comment ne pas être déçu par une réalité qui en comparaison apparaît nécessairement bien fade ! Les gens, et de surcroît les personnes souvent précarisées avec qui l’on travail dans l’action sociale, ne ressemblent en rien à l’idéal-type du citoyen (ils veulent quelque chose et le lendemain son contraire, ils s’impliquent une semaine et on ne les voit plus pendant un mois) … tout dans la participation nous renvoie à notre propre médiocrité d’individu. Dès lors c’est peut-être la représentation de ce qu’on entend par « participation » qu’il faudrait faire évoluer, quitter le fantasme et entrer dans le réel, faire avec « ce qui est » (la participation réelle) et non avec « ce qui devrait être » (la participation fantasmée). Cela permettrait peut-être de relativiser les attentes liées à la participation, de cesser de dénoncer comme du « consumérisme » les attitudes qui ne correspondent pas à notre vision idéalisée, bref de prendre les gens comme ils sont en laissant de côté la rhétorique passéiste du « c’était mieux avant » ou du « aujourd’hui les gens ne s’engagent plus … »
La participation et le conflit social
Le dernier point qu’il me paraît important de mentionner est lié aux conséquences de l’ouverture d’un espace démocratique. Il ne faut jamais oublier que la participation génère du conflit au moins autant qu’elle ne l’apaise, ou en tout cas, qu’elle rend visible, publicise les rapports conflictuels. Ainsi, plus vous ouvrez des espaces de paroles plus vous créez des conflits potentiels et des occasions de montrer ses désaccords. J’ai été récemment amené à organiser une concertation pour Réseau Ferré de France dans le cadre des projets GPSO (installation de lignes à grandes vitesse dans le Sud-Ouest de la France). Il est frappant de remarquer que pendant très longtemps les dirigeants décidaient unilatéralement que telle voie ferrée passerait à tel endroit ou que telle route couperait telle propriété. Bien sûr il y avait des mécontents, des « victimes » de ces projets (et en premier lieu ceux dont on rasait les maisons) … mais on ne les entendait guère. La voie ferrée ou la route était construite sans conflit majeur apparent. Désormais on met en place de grandes concertations ou non seulement on informe les gens mais en plus on leur demande leur avis. Pas d’illusion toutefois : tout n’est pas transparent et bon nombre de décisions ne tiennent pas réellement compte de la concertation. Mais, force est de reconnaître que c’est à l’heure où la parole des gens est davantage prise en considération, que nous n’avons jamais autant parlé de « manipulations » , d’Etat qui se comporte en « rouleau compresseur », de « mépris des citoyens ». En ce sens, plus les autorités sont démocratiques plus les citoyens semblent exigeants. Reste que la multiplication des conflits liée à l’ouverture d’espaces démocratiques ne doit pas être interprétée comme le signe d’un dysfonctionnement social (auquel cas on cesse de mettre en place des dispositifs participatifs), mais bien au contraire comme le signe de la vitalité du corps social et des acteurs qui le compose.
En guise de conclusion …
Si l’on résume, mettre en œuvre concrètement la participation des usagers, des habitants ou des familles, passerait par l’abandon d’une posture de surplomb, l’acceptation de l’incertitude générée par l’irruption de l’Autre (social) ; impliquerait de faire avec les « faiblesses » de chacun et risquerait d’amplifier les conflits sociaux ! On comprend dès lors pourquoi il est si difficile de mettre œuvre dans les faits ce qui semble acquis dans le discours … et l’on mesure aussi le véritable défi que pose aux professionnels la problématique de la participation.
La participation devient alors un « indicateur » précieux, une « porte d’entrée » pour travailler en profondeur la question de la posture professionnelle.
Bertrand Hagenmüller, Conférence-article, pour le Conseil Départemental de la Gironde (2011)