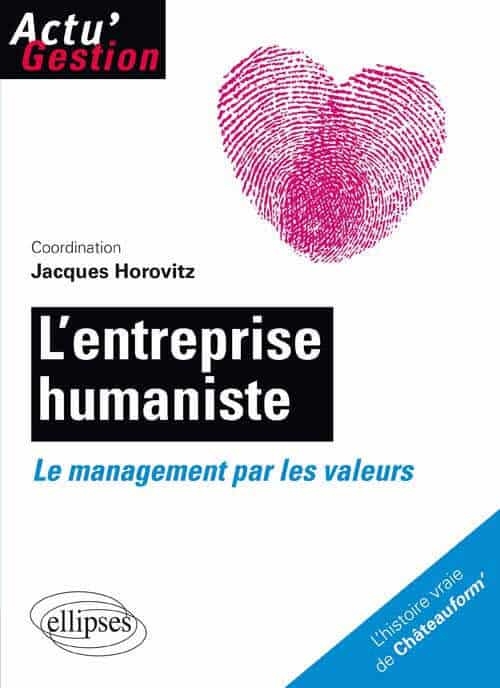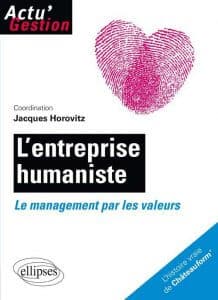Justice, vérité, liberté, dignité, honneur, solidarité, loyauté, respect, reconnaissance, sont au cœur des RPS, non comme valeurs mais comme pathos, non comme désirs mais comme manques, rarement aussi comme questions. C’est ce que l’on appelle pudiquement la perte de sens, lorsque l’on désespère de comprendre, et pire encore lorsqu’il n’y a plus rien à désirer, pour l’animal laborans ..
Comment en arrive t-on à imposer des cadences intenables, des surcharges de travail, des pressions psychologiques ? Qui décide de doubler les objectifs de croissance de rentabilité ou de profit ? Au nom de quelles rationalités ? En vue de quoi ? Qu’est-ce qui tue le désir et la puissance d’agir entre ordres absurdes et contrôles obsédants ou jeux de pouvoirs insensés ? Qu’est ce qui est injuste ou indigne ici, et pour qui ? En quoi et à quels propos est-il nécessaire d’évaluer nos valeurs sans lesquelles le travail n’a pas de valeur ?
Si ce terme consensuel et parfois cynique de « RPS » laisse à penser que ces facteurs de risques pour la santé mentale, ne sont pas le fait d’une volonté autonome, mais le produit d’un système, se pose alors la question de la résistance à cette « irresponsabilité» mécanique, qui se joue subtilement dans chaque rouage de l’organisation. S’il nous pousse aussi à reconnaître désormais l’existence d’un Sujet au travail moralement vulnérable, nous pouvons penser la capacité de l’éthique, comme « philosophie première » du côté de la création concertée de sens et de valeurs, anti-dote pour les un et les autres à la passivité.
C’est d’une pratique paradoxale de médiation dont nous voulons témoigner, cherchant à conjuguer une posture de neutre ardent comme dit Rolland Barthes, capable dans les conflits de déjouer « le binarisme des oppositions» et une audace de questionnement permettant de penser ensemble le travail et ses humanités.
Nous tenterons d’en apercevoir l’efficience dans la construction des responsabilités et des compromis de sens « mutuellement acceptables » ; Un processus qui favorise le passage de la norme unilatérale à la vérité partagée, la production d’un réel sens commun.
Bibliographie :
Hannah Arendt – Condition de l’homme moderne – ed Pocket
Hannah Arendt – Eichmann à Jérusalem – ed. folio histoire
Paul Ricoeur – Parcours de la reconnaissance – ed. folio essais
Epictète – Ce qui dépend de nous – ed. arléa
Henri Arvon – La philosophie du travail – ed. PUF
Emmanuel Levinas – Liberté et Commandement – ed Le livre de poche, biblio,
Michel Foucault – Le gouvernement de soi et des autres – ed. Gallimard Seuil
Rolland Barthes, Le Neutre, Cours au Collège de France, 1977-1978, en 2 CD, ed. Seuil
Olivier Abel – De l’amour des ennemis et autres méditations sur la guerre et la politique, P.195, ed. Albin Michel, 2002.
« Agis donc de telle sorte que tu traites l’humanité,
aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre,
toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen » .
Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant 1724
Conférence
Je remercie François Hubault de m’avoir donné cette occasion de réfléchir plus avant à cette question-là, pour laquelle je me sentais doublement concerné, en tant que psychosociologue et en tant que philosophe. Car ce terme de risques psycho-sociaux, polysémique à souhait, semble bien vouloir désigner une origine des risques autant qu’une nature, et nous pousser, nous intervenants, à nous questionner à la fois sur les systèmes d’interactions aveugles que sur la reconnaissance d’un sujet au travail, moralement vulnérable.
1. La vision psychosociologique des RPS
1 – 1 L’adjectif « psycho-sociaux »
Je m’interroge sur cet adjectif psycho-sociaux, qui selon les usages s’écrit avec un trait d’union ou pas, avec ou sans majuscule à l’un et l’autre terme. Que veut-on signifier ? L’articulation et la distinction entre ces deux champs, le psychologique et le social, tout en gardant la primauté de l’un sur l’autre ou l’émergence d’un champ complexe, permettant de penser les deux en un ?
C’est assurément le champ de la psychosociologie, comme discipline d’étude et d’intervention, que de chercher à comprendre les rapports réels et imaginaires entre individu et société, d’analyser les influences du groupe sur les comportements individuels, depuis l’organisation objective jusqu’aux invisibles jeux interpersonnels. C’est une orientation clinique alliée à une posture d’étonnement, qui permet notamment d’observer comment les organisations suscitent des comportements contraires de ceux qu’elle réclame.
1) La solidarité dans les vignes
Pour exemple, quasi caricatural, je me souviens d’exploitants viticoles, se plaignant du manque total de solidarité entre les vendangeurs et que j’avais d’emblée questionnés, à leur corps défendant, sur leur organisation :
« Comment les formez vous ? », « On leur passe une cassette vidéo à leur arrivée »
« Comment les logez vous ? » , « Pour éviter tout conflit, ils sont logés dans des baraquements aux quatre coins de la propriété, en séparant les Marocains des Tunisiens et des Algériens »
« Faites vous des repas en commun », « Non, vous n’y pensez pas, qui aurait le temps de les préparer ! »
« Comment travaillent-ils ? », « Ils vendangent chacun seul dans sa rangée, pour prévenir les disputes et chaque cageot porte leur numéro afin de contrôler la qualité de leur production ».
Je vous passe les détails, mais ceci pour montrer comment par ces questions, ne portant pas sur les individus eux-mêmes, mais sur les processus, il est possible de mettre en évidence l’origine psychosociale des comportements incriminés, dans cet exemple, des facteurs organisationnels convergents susceptibles de favoriser le repli individuel et d’alimenter les tensions entre les communautés.
1 – 2 Une approche systémique
Outre ces éléments objectifs d’organisation, je cherche à déceler pour pouvoir les déjouer, des mécaniques interactionnelles aberrantes qui, dans bien des cas, échappent aux intentions des acteurs.
2) A la maison
Si je rentre à la maison en disant : je suis fatigué et que ma femme me répond instantanément : moi aussi, ce qui est très fréquent, et s’il me vient alors à l’idée de renchérir par un : « oui mais moi j’ai fait une conférence fort importante et veillé tard pour la préparer », ce mais moi met en place une petite mécanique d’escalade, qui risque bien de nous valoir une fort mauvaise soirée, si aucun des deux ne s’avise de chercher à l’enrayer.
3) Dans une circonscription d’action sociale
Des assistantes sociales sont en conflit avec des secrétaires d’accueil. Les secrétaires se sentent méprisées et maltraitées par les AS, qui elles-mêmes se plaignent de l’action stressante des secrétaires à leur égard et de leur manque de bonne volonté dans l’accomplissement des tâches qu’elles leur confient. En s’interrogeant sur leurs modalités de communication, les AS localisent l’origine de leur stress du coté de ces manières récurrentes qu’ont les secrétaires de les appeler : « Il y a ton urgence à l’accueil, dépêche-toi !». Ou encore lorsqu’elles font sonner le téléphone trois fois, juste le temps pour l’AS de courir à son poste et d’arriver trop tard pour répondre. Ces petites sources d’agacement provoquent par la répétition et l’habitude, des réactions en chaîne et des procès d’intention sans commune mesure, qui alimentent conflits et inimitiés.
4) Dans une usine agro-alimentaire
Une ouvrière occupe un poste de « pilote de ligne », sur une chaîne de conditionnement de packs de compotes de pommes en coupelles aluminium. Son travail consiste à approvisionner et contrôler une machine sophistiquée d’emballage et, en cas de blocage des coupelles, à actionner le bouton d’arrêt de toute la chaîne avant que celles-ci n’explosent obligeant au nettoyage long et coûteux de la machine. Il lui arrive par deux fois consécutives, de ne pas stopper la chaîne au bon moment. Cette ouvrière sans problème jusque-là, compétente et appréciée, fait alors l’objet de toutes les sollicitudes ; on lui demande si elle a des soucis chez elle, on la met en garde chaque matin de faire attention, de ne pas être distraite, sur un ton mi-compatissant, mi-menaçant. Pour autant, le problème s’aggrave jusqu’à son affectation à un poste semblable sur une nouvelle ligne de production, non plus cette fois rectiligne mais faisant un coude juste avant son poste. De ce jour-là, désormais à l’abri du regard de ses collègues, elle cesse d’être distraite !
Dans cette histoire dont l’heureuse issue est le fruit du hasard, on peut voir comment l’injonction quasi mécanique faite à cette femme de « faire attention » et les multiples tentatives de contrôle de sa vigilance, ont contribué à chroniciser le problème et cela avec les meilleurs intentions du monde.
Pour autant, il serait naïf de croire que la seule élucidation de ces mécaniques interactionnelles, au motif d’une prise de conscience, ou de leur substitution experte par d’autres process plus performants, suffise à les épuiser et moins encore à en changer le sens. Il s’agit peut-être, comme le disait Hannah Arendt à propos de Socrate, de paralyser provisoirement, l’action (mécanique) par la pensée, chercher ensemble ce qui peut faire rupture, grain de sable, pour restaurer la sagacité, l’initiative, et la responsabilité. Plus encore penser ensemble le travail, sa philosophie, ses conséquences politiques, c’est courir d’autres risques psycho-sociaux, non pas subis, mais choisis, non plus ceux qui provoquent suicides et passions tristes, mais ceux là même inhérents à notre vulnérabilité morale, qui nous rendent vivants et libres dans un monde commun.
2. La philosophie au travail
Lorsque mon fils cadet avait six ou sept ans, nous avions convenu qu’un soir sur deux, avant de dormir, nous nous poserions mutuellement des questions au lieu que je lui raconte des histoires. J’ai souvenir d’une fois où il m’avait d’abord demandé combien il y a de fourmis sur terre, question qui m’avait beaucoup embarrassé et à laquelle j’avais répondu par une pirouette sur le nombre de fourmis possibles sur un cm2. Après quoi je lui avais proposé par jeu, de m’expliquer quelle différence il faisait entre l’espace et le temps. Il avait réfléchi un moment, puis donné avec beaucoup de sérieux, cette réponse d’une incroyable pertinence philosophique : « oh là là, l’espace c’est beaucoup moins profond que le futur ! »
C’est un exemple parmi tant d’autres, qui nous rappelle si besoin, à quel point le questionnement philosophique, habite tous les âges et toutes les conditions, pour peu qu’on en cherche l’occasion ; une façon aussi d’illustrer cette posture de philosophe que j’essaie de tenir, par laquelle notre philosophie en héritage, celle qui s’écrit, se lit et s’enseigne, doit pouvoir faire la place à une philosophie en dialogue, chaotique et inchoative..
En prenant le parti depuis plus de 20 ans, de cultiver ces occasions de philosopher au travail, j’ai bien sûr rencontré nombre de DRH, responsables de formation, ou dirigeants, me disant : « Faites attention, si moi j’aime me poser des questions et réfléchir à ces enjeux-là, eux risquent de ne pas comprendre. Ce qu’ils veulent, c’est du concret et des outils ! » Ou encore : Moi, vous savez, je suis pragmatique ! L’idéologie du pragmatisme est à mon sens au cœur des RPS, quand elle justifie coûte que coûte la recherche d’efficacité à court terme et l’absence de réflexion sur la complexité des enjeux humains au travail.
Mais j’ai tout autant constaté derrière les positions de principe, le désir criant de prendre du recul, de sortir la tête du guidon, de penser ensemble d’autres horizons et raisons sociales que le résultat immédiat
On invoque à qui mieux mieux une quête de valeurs ou de repères, et les vendeurs de valeurs se bousculent à tous les coins de rue. Mais il me semble, que cette quête-là, au-delà de l’illusion consumériste, ne requiert pas des valeurs en prêt à penser, des cartes d’état-major pour savoir comment s’orienter chaque matin ou des morales d’emprunt. Plutôt qu’une simple quête de valeurs morales, je veux croire qu’il s’agit d’ un désir vital d’être source de valeur pour soi et pour les autres, auteur de son travail avant d’en être acteur, afin de concilier le beau travail avec le bien vivre ensemble.
Toutes les plaintes au travail, relatives aux RPS, parlent de justice, de vérité, de dignité, d’honneur, de respect, de reconnaissance, autant de références philosophiques qui, bien loin de désigner des réalités univoques et semblablement entendues, condensent expériences, désirs, impuissances, doxa et pensées singulières. Crier justice par exemple, peut s’entendre comme un désir d’entente devenu désir de vérité (au moins savoir pourquoi), puis volonté de Justice (être reconnu dans son droit), et parfois rêve de vengeance ( en finir )…
2 -1 . L’hospitalité de la plainte
La question des RPS se pose certes en termes juridiques, de qualité, de coûts, mais d’abord en termes de plainte. On se plaint des rythmes, des pressions, des injustices, du non-sens, de harcèlement, de l’absurdité du travail, des collaborateurs « boulets », des chefs despotes, etc. On vient nous voir avec une souffrance, une contestation, une revendication, une récrimination, une demande de réparation. Et alors ? Qu’en fait-on de cette plainte ?
On l’enregistre, on la soigne, ou bien on lui donne l’hospitalité ? D’un point de vue épistémologique, ce sont trois modes d’écoute et d’objectivation possibles fort différents, qui ne sont pas sans effet, loin s’en faut, sur la nature même de la plainte et ses conséquences. L’enregistrement reconnaît un sujet de droit, inscrit le dit dans un ordre légal et institutionnel et donne un statut de victime au plaignant, qui peut attendre dès lors que la justice soit rendue. Le soin reconnaît la souffrance et éventuellement une pathologie, qui donne un statut de patient, justifiant d’un traitement. L’hospitalité est à mon sens d’ordre éthique, elle fait place à la singularité du Sujet et à la différence.
A la maison, donner l’hospitalité à un étranger, c’est d’abord, l’inviter à s’asseoir dans le salon et lui dire : ne bougez pas je vais chercher l’apéro. Ce n’est pas d’emblée lui dire : allez où vous voulez ! Il s’agit de prendre le temps de s’observer pour s’assurer des bonnes intentions de son hôte, mais aussi transmettre les us et coutumes minimum, s’accommoder d’étranges usages, reconnaître l’Autre en renonçant à tout comprendre, se laisser étonner. C’est à la fois une disposition d’ouverture et une structuration de la relation.
Donner l’hospitalité à la plainte signifie que l’on va l’asseoir, la regarder ensemble, peut-être se laisser dépasser par elle, avant d’en déterminer la nature et la cause. Or si j’ai connaissance des RPS à la mesure de l’accès à la plainte, instituer ce choix de l’hospitalité, induit un rapport de co-responsabilité, par lequel il devient possible de chercher ensemble les remédiations possibles.
2 – 2. Deux expériences en matière de réparation des RPS
1) Les gardiennes de musée humiliées:
Dans un petit musée, installé dans une maison de maître, en pleine campagne, j’ai pour mission d’accompagner l’autonomisation des musées du Département et l’enrichissement des tâches des gardiens. Lors d’un entretien avec une gardienne, celle-ci se met à pleurer en me confiant qu’elle vit un calvaire dans ce musée depuis 15 ans, à cause du gardien chef. « Il m’envoie tous les jours au troisième étage, qui ne reçoit jamais de visiteur, sauf les enfants le mercredi, pour des ateliers animés par une conférencière que je n’ai même pas le droit d’aider. En plus chaque matin, il nous réunit (les dix gardiennes) à la queue leu leu devant lui, pour nous attribuer chacune notre tour, les tâches ménagères, qu’il inscrit dans un grand cahier. Et chaque fois, je ressens cela comme une humiliation. » Une autre gardienne chargée de la vente des cartes postales me confie aussi, que lorsqu’elle compte les recettes de sa journée, il passe dans son dos, ce qui provoque chez elle une espèce de panique, toujours suivie d’une erreur de calcul. Il lui dit alors systématiquement: « Heureusement que je suis passé par là! » Est-ce un risque psycho-social ?
J’ai arrêté de mener ces entretiens individuels, qui sont comme des réservoirs de plaintes, et nous nous sommes mis tous autour d’une table, avec l’idée d’exercer ensemble cette hospitalité. C’est-à-dire d’objectiver, en regard du sens du métier, du sens du projet muséal, du sens des responsabilités de chacun, ce qui faisait l’objet de tant de ruminations et de souffrances. J’ai demandé aux gardiennes et au gardien-chef réunis, d’écrire ce qui leur paraissait particulièrement signifiant de leur métier et de leurs conditions de travail et important à dire ce jour-là, pour qu’on puisse en discuter ensemble. Cette femme qui s’était confiée à moi, sans doute la plus « touchée », a lu la première ce qu’elle avait écrit, dans un style concis et descriptif, tout ce qui lui rendait la vie impossible, toute cette organisation qui n’avait pour elle aucun sens. Après un long silence, le gardien-chef a dit : « je me rends compte de ce que c’est que la connerie humaine ». Il parlait de lui bien sûr ! et ajouta : « Je pensais que c’était une bonne manière de varier les tâches et d’impliquer mon équipe ».
À partir de ce jour-là, s’est mis en place un collectif de travail, sous la responsabilité du conservateur, pour repenser la place des gardiens au sein du projet muséal, dont ils voulaient être porteurs. En lieu et place de l’invivable distribution des tâches, ils ont instauré une réunion conviviale pour démarrer la journée, au cours de laquelle ils se partageaient le travail et faisaient le point sur les actions en cours ou les difficultés rencontrées.
La morale de cette histoire est de pouvoir se dire que la bêtise est beaucoup moins épaisse qu’elle ne paraît ! C’est aussi un choix éthique, que de ne pas assigner le sujet à ses actes et de pouvoir penser l’autre de l’autre, y compris chez le pervers ou le criminel. Elle induit en matière de médiation, une naïveté méthodique et critique, qui s’abstient d’interpréter les intentions à partir des signes aussi évidents soient-ils et crée des accès nouveaux à l’altérité.
2) L’homme qui n’avait pas de cœur
Un directeur général réunit en séminaire annuel de deux jours l’ensemble des directeurs de foyers accueillant des personnes handicapées mentales de la région. Il souhaite que je facilite leurs réflexions sur les mutations en cours et sur la philosophie commune de l’équipe. Mais à peine assis, je croise le regard incendiaire d’une participante à qui il me paraît indispensable de demander sans délai ce qui ne va pas. Elle me répond : « l’homme qui est à coté de vous n’a pas de cœur ! ». Je choisis en médiateur de me mêler de ce qui ne me regarde pas, par ces questions qui consistent à localiser, discriminer, requalifier le propos, ses raisons et son histoire: A propos de quoi et depuis quand pensez vous une chose pareille ? Que faites-vous depuis ? et vous-mêmes monsieur, comment comprenez- vous une pareille accusation, quel effet produit-elle, etc. ? C’est un travail d’anamnèse du jugement et de contextualisation, qui permet de sortir des généralisations. Elle explique qu’elle a été contrainte de nous rejoindre par une lettre recommandée reçue à son domicile, lui en faisant l’injonction, alors que le lendemain aura lieu l’enterrement d’une de ses résidentes. Celle-ci, vivant depuis quinze ans au foyer, avait décidé de se donner la mort, en cessant de s’alimenter, alors que toute l’équipe s’était battue coûte que coûte pour l’en empêcher. La directrice rajoute aussi que son directeur lui avait demandé de se faire représenter par son adjointe, ce qu’elle trouve tout à fait cynique !
C’est évidemment une énorme perte de sens pour elle, qui croit en l’humanité partagée de ce métier. C’est en même temps un fort sentiment d’injustice, vis-à-vis des prérogatives d’un chef, qui n’a pas à son sens, le droit (moral) de s’ingérer dans ce qui pour elle relève de choix personnels inaliénables.
On s’est demandé ensemble ce qui est juste dans une histoire pareille. Pour le Directeur, ce qui lui semblait juste, c’était de tenir un cadre, d’empêcher à cette subjectivité de s’exercer aux dépens de l’intérêt général. Mais il a reconnu qu’il s’était montré aveugle et tyrannique dans cette occasion-là, en réaction à bien d’autres situations où elle avait, pensait-il, volontairement échappé aux contraintes institutionnelles, notamment par son absence répétée à ces réunions régionales. Il supposait que ce faisant elle cherchait à maintenir son indépendance, au mépris d’une appartenance de tous les foyers à la même association et à se soustraire aux nouvelles règles de gestion centralisée des établissements. Ce qu’elle concevait comme son autonomie légitime, lui, l’interprétait comme une volonté d’indépendance.
Nous sommes sortis ensuite du problème, pour réfléchir ensemble sur la question du commandement tyrannique, en nous appuyant sur la lecture d’un texte d’Emmanuel Lévinas . Qu’est-ce qu’un acte tyrannique ? A partir de quel moment le devient-il ? Comment sortir de ce paradoxe du commandement qui en appelle à la responsabilité par définition autonome du sujet, à sa nécessaire liberté et qui en même temps suppose l’obéissance ? A la pause, ils se sont expliqués plus avant et mis d’accord, pour que la directrice se rende aux obsèques, puis revienne participer à la fin du séminaire. (Ce qui lui demandait l’effort de parcourir plus de deux cents kms.
Ce qui a fait réparation, autant que prévention, me semble-il, c’est déjà d’avoir simplement pu penser ensemble, en égalité de parole, par la médiation des tiers. C’est aussi d’avoir mis un terme provisoire à l’escalade des surinterprétations sans conteste, d’avoir réactualisé des valeurs communes, essentielles au désir de ce travail, d’avoir construit des compromis de sens.et d’action.
2 – 3. Du coté de la prévention, l’éthique comme Philosophie première
L’atelier de philosophie à l’hôpital
J’anime un atelier de philosophie du travail, une fois par mois, une matinée entière, auprès d’un groupe mixte de médecins, directeurs d’hôpitaux et cadres administratifs. Des métiers et fonctions aux rationalités très éloignées les unes des autres, alors que chacun s’attend à partager un monde commun, d’intérêts et de valeurs convergents.
Un sujet choisi à la majorité du groupe : « Peut-on manager sans maltraiter ». Pourquoi un sujet pareil ? Parce que le manager, bien souvent, se sent étranger à ces orientations et injonctions qu’il est chargé de « faire passer ». Les réformes hospitalières allant d’un tel train, on peut penser que les managers ont à les mettre en œuvre avant de se les approprier, bien loin d’en partager les raisons.
C’est d’ailleurs une problématique managériale fréquente, (un RPS ?) que de devoir imposer aux autres ce qui paraît inepte, voire que l’on réprouve soi même. Faire adhérer à une politique commerciale, à un plan de restructuration, ou à un nouvel outil de gestion, est un leitmotiv volontariste, qui semble vouloir faire l’économie de la transmission et du débat
Ces « matinales » sont donc l’occasion de prendre de la hauteur de vue en exerçant une liberté de penser à voix haute. Elles favorisent un dialogue réel, (par lequel la raison de l’un peut éclairer celle de l’autre), sur les questions éthiques que posent inévitablement tel ou tel choix gestionnaire ; une manière de clarifier ce qu’on est tenu de faire, jusqu’où, pourquoi et ce qu’on veut en faire, compte tenu des responsabilités et références de chacun.
3. Vers une éthique partagée
Penser ensemble des impensables, faire parler nos chères valeurs, trouver les accès de l’une à l’autre, décongeler ou déplier ces mots « mana » , censés faire sens commun, se réjouir de douter ensemble des certitudes immobiles, déclencher des processus de rationalisation créatifs, c’est l’affaire d’une éthique partagée. Nos valeurs indiscutées nous tiennent éloignés du réel et des autres au risque de devenir des idéaux persécuteurs. Comment le sait-il l’autre, à quel point tel ou tel signe me fait violence, à quel point il en va de mon intégrité, que de me soumettre à cet ordre-là, dont l’absurdité tue mon désir d’agir ?
Pour nous, intervenants, il s’agit d’en rechercher les conditions de possibilité, non pas de venir avec une éthique « en boite », ou en charte, aussi universelle soit-elle. Quand on se pose entre nous, explicitement, au beau milieu du travail, des questions de justice, de vérité, de liberté, de dignité ou de responsabilité, ce n’est ni pour asséner une leçon de morale de plus, ni pour faire une dissertation savante. C’est pour identifier ces blocs de pensées, préjugés, clichés, stéréotypes, qui nous tiennent enfermés en nous-mêmes. C’est aussi pour les déconstruire, non pas les mépriser, mais tenter de retrouver en eux une multiplicité de significations vives partageables. C’est encore pour mettre en perspective idéaux et pratiques professionnelles dans des allers-retours incessants.
Cela suppose des lieux et temps, en dehors des urgences, où l’on recherche ces conditions du penser et de la délibération qui me paraissent proches de la parrêsia grecque dont parle Michel Foucault, à savoir : garantir une égale liberté de parole, (quelques soient les statuts), se parler en vérité (non pas en langue de bois), avoir le courage de dire ce que l’on pense (au risque d’être contredit), assumer quand même le jeu de l’ascendant (exercer ses responsabilités statutaires).
Passer du registre de l’obligation morale unilatérale à l’éthique partagée, ce n’est pas adhérer ou s’adapter un peu plus, c’est rechercher les conditions du désir d’agir ensemble, actualiser les consensus et consentir à d’inévitables compromis, comme dit Olivier Abel , « l’acceptation du fait que les désaccords sont indépassables ».
4. Discussion
« Vous avez parlé de mettre un grain de sable dans la mécanique, de revenir à un mouvement libre, j’aimerais bien que vous développiez cela. »
« L’intervention que vous décrivez suppose un préalable, c’est qu’il est admis que tout le monde soit autorisé à chercher du sens dans son travail, non pas que certains pensent le sens et d’autres l’exécutent. »
« Je reviendrai sur la quête de sens, c’est une question que la plupart des intervenants partagent. Mais quand on regarde dans les entreprises, la question qu’on nous renvoie, c’est ce qui fait sens pour moi, ne fait pas sens pour l’autre. Construire le sens pour le manager cela ne s’opère pas dans le même temps que pour ses collaborateurs. A quels référents cela renvoie t-il pour chacun de nous et dans quelles temporalités l’inscrire ? »
« Ce que vous dites me parle beaucoup et fait écho à ma propre expérience. Dans la question du sens, j’y vois deux sens : la question des valeurs propres de chacun et des différends entre chacun, des différences qui peuvent devenir des différends. Et il y a à ce moment-là l’explication du sens des différends par l’explication des différences. Ensuite, il y a la question du sens collectif au travail, de ce qu’est un « beau » travail. L’exemple que vous donnez de cette femme qui veut se rendre à l’enterrement de sa résidente, il n’est plus question de différences, mais du sens de ce qu’est un beau travail. C’est une mécanique un peu différente qui s’installe. »
Je ne sais pas si j’utiliserai l’expression quête de sens, qui renvoie à l’idée d’un sens déjà là, vérité révélée, en possession d’un expert. Avec cette demande de sens tout fait, on croit un peu au père Noël, pouvoir passer commande d’un sens qui nous éviterait de chercher par nous même et d’en prendre la responsabilité. Mais c’est une illusion consumériste qui ne résiste pas à l’usage.
Chacun dans son métier, qu’il soit médecin, gardien de prison, dirigeant d’une PMI ou ouvrier posté, s’est construit une idée propre et singulière de l’intérêt général, des convictions bien trempées sur ce qu’est un « beau travail ». L’organisation, les collègues, les contraintes de moyens, trahissent en permanence ces idéaux professionnels. Et c’est assurément une source importante de réprobations, mésestimes et conflits, à moins que ces références idéales ne soient partagées et mises en perspective des contraintes, à moins de rechercher ensemble les compromis mutuellement acceptables.
Une équipe de PMI en souffrance
Je suis intervenu dans une PMI (Protection Maternelle et Infantile), auprès d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologue, sage-femme, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et puéricultrice directrice). Ils souhaitaient un intervenant pour les aider à sortir d’une souffrance, due à des inimitiés entre eux de longue date, à l’absence de communication, à une mauvaise réputation, etc.
Il m’a semblé que l’équipe fonctionnait comme en huis clos, en raison de la promiscuité quotidienne, vécue de longue date pour la plupart d’entre eux, mais aussi à force de durcir les règles, afin que les usagers ne les changent pas pour ne pas prendre le risque oh combien invoqué, de ne plus « tenir le cadre ». Dans ce huis clos intimiste, il n’était plus jamais question de discuter de l’intérêt général, ces raisons d’être de l’activité censées aller de soi: le service rendu, la protection maternelle et infantile, le sens de l’accueil, la confidentialité, la responsabilité individuelle et collective. Car ces valeurs-là sont conçues comme des normes univoques qui s’incarnent dans des règles formelles institutionnelles, dont chacun attend la stricte observance par les autres. Il n’était pas un jour sans qu’un professionnel ne se sente pris en faute, mis en demeure de s’expliquer sur tel ou tel manquement contrevenant à la règle explicite, faisant alors symptôme d’un désaccord inacceptable sur les valeurs essentielles de l’action collective. Sous prétexte de confidentialité par exemple, on avait institué deux cahiers de transmission l’un pour les médecins, l’autre pour les personnels para-médicaux. Voilà une déclinaison de la valeur qui à l’usage devient la valeur elle-même, intouchable, aux conséquences désastreuses pour les coopérations, les contributions des uns au travail des autres.
Au li eu de traiter exclusivement de ces « dysfonctionnements » d’équipe, nous avons recherché ensemble la valeur des valeurs communes, repensé ces questions philosophiques pouvant orienter l’action : Que veut dire protection de l’enfance ? Quelle est la commande politique ? A quelles valeurs sociétales cela correspond-il ? Quel est le sens de la confidentialité ? Pourquoi les usagers feraient des confidences et pourquoi ne voudraient-ils pas qu’on parle d’eux ? En en parlant explicitement on a évidemment fait apparaître des différences d’interprétation des uns et des autres, d’un métier à l’autre, mais on a surtout réactualisé et originé du sens commun chez chacun. Les auxiliaires de puériculture par exemple, qui contrairement aux autres personnels, sont à plein temps dans la structure et qui se plaignaient d’être sans cesse sous contrôle, corvéables à merci, ont pu réaffirmer la légitime autonomie de leur métier qui ne les prédispose pas à être de simples exécutants, mais leur donne prise sur les enjeux humains de l’activité. Partant de là, nous nous sommes efforcés de retrouver des accords de coopération plutôt que de renforcer des règles de subordination.
C’est le principal rôle du tiers, non pas de se battre à armes égales, mais de faire office de grain de sable par sa naïveté insoumise et d’en créer la place pour d’autres.
« C’est un long processus que de déconstruire et reconstruire du sens commun, avec des inévitables compromis, qui nécessite du travail sur les représentations, les croyances, au-delà d’une simple discussion. On ne peut pas prendre cette affaire à la légère, en disant qu’il suffit d’un petit grain de sable et tout redevient clair. Le cheminement de cette transformation est exigeant en termes d’investissement, de temps et de méthodologie. »
« Je suis médecin du travail, pas très philosophe, plutôt terre-à-terre. Par rapport aux termes que vous employez, réfléchir, penser, pourquoi ne pas parler de développement de la pensée, où l’on guiderait les salariés pour leur restaurer un pouvoir d’agir sur des temps connexes libérés par l’employeur ? Mais dans ce cas là, n’est-ce pas dangereux pour l’employeur, est-ce qu’il va nous laisser faire ? Est-ce qu’il pense toujours comme avant, que le salarié n’est qu’une force de travail physique ou qu’il est également un homme doué de pensée ? »
Ma métaphore du grain de sable semble vous évoquer la légèreté ou l’inconséquence, je l’entends du coté de la modestie et de la disproportion des moyens. Il y a des machines – de guerre, comme dirait G. Deleuze – qui ne sont pas si puissantes qu’elles n’y paraissent dès lors que l’on trouve le bon grain de sable ou si vous préférez ce presque rien d’étranger au système, ou encore ces apories qui obligent à s’arrêter. Il faut évidemment une certaine résistance et la puissance subversive du désir de philosopher au travail.
Sujets rédigés par les participants
• Quelles sont les perspectives de survenance d’une véritable construction d’un mode de pensée centré sur le bien être de l’homme au travail au sein des organisations ?
• Tout le monde est-il autorisé à chercher du sens dans son travail ; en d’autres termes, dans le quotidien des organisations, n’y a-t-il des valeurs qui sont légitimes et d’autres qui ne sont pas reconnues comme légitimes ?
• Ne pas être réservoir de la plainte : tout à fait juste. Déplacer la souffrance, recentrer les débats sur le travail pour développer sa pensée et retrouver le pouvoir d’agir sur ses conditions de travail pour ne plus subir.
• Devenir acteur de la prévention c’est aussi redonner du sens à son travail pour participer à soigner son travail, donc le salarié .
• Que signifie revenir à un mouvement libre ? s’agit-il de liberté de mouvement ou de nouveauté du mouvement ?
• Laisser émerger et accueillir le nouveau, se surprendre, se laisser surprendre ?
• L’importance de l’ouverture pour l’intervenant vers le sens de l’autre.
• Quelles visions de l’homme ont les entreprises ? quelles visions de la vie ? est-ce que ces visions traversent leurs décisions ?
• Y a-t-il une place pour l’affection dans les relations de travail ? pour l’amour (sexualité mise à part, si c’est possible) ?
• Comment résoudre la contradiction des deux approches de résolution des conflits ? le construire ensemble ou la nécessité du rapport de force.
• Le salariat : déjà une grande perte de sens ?
• Humanité au travail
• Faites-vous une différence entre la demande et la plainte ?
• Aujourd’hui le discours dominant laisse penser que tout est possible sans faire de distinction entre possible et probable. Que dit le philosophe sur ce sujet ?
• Juste, Justesse, Ajustement, Justice… dans l’intervention !
• Les risques « psycho-sociaux » « le risque psycho-social », drôle de formulation… Le psychosocial serait en soi un risque ?
• Avoir trop de liberté est elle une contrainte (on en a parlé ce midi) ? comme cela peut se voir dans certaines situations de travail
• Les RPS parmi les professeurs du secondaire ? Le système scolaire (institution) et ses spécificités (les adolescents /carences éducatives/violences…) Permet-il l’introduction du tiers pour soulager les professeurs en difficulté ?
• Hospitalité de la plainte. Réparation de la plainte plutôt que la gestion des RPS, modèle économique
• Pouvoir et délégation de pouvoir
• Peut-on évaluer des RPS ? et traduire cela par des chiffres dans une colonne d’un document unique ?
• Être ou ne pas être dans l’hospitalité ?
• Le non choix du salarié a qui l’on donne de sur-choisir en tant que consommateur
• Peut-on travailler seul ou doit-on travailler avec les autres ?
• Le travail procède-t-il vraiment d’un système organisé ?
• Beaucoup construisent des murs, peu construisent des ponts ?
Bernard Benattar philosophe du travail, psychosociologue, Institut Européen de Philosophie Pratique
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]